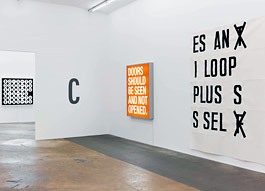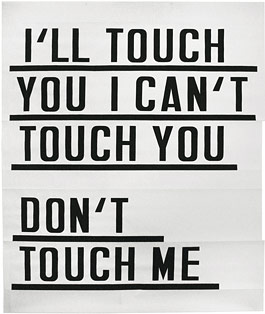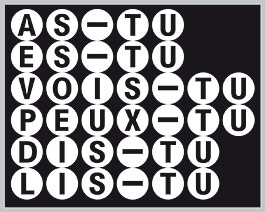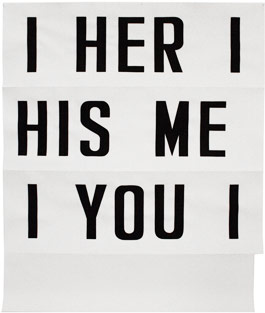À la lecture du titre de l’exposition d’Alex Hanimann, tout
lecteur francophone sera surpris par ce qui semble une
juxtaposition fautive de deux mots, « Double entendre ». Ou,
pour le moins, une bizarrerie linguistique. Cette étrangeté de l’intitulé guette le spectateur tout au long de l’exposition.
Ces œuvres qui font la part belle aux jeux de langage,
constituent une part importante du travail d’Alex Hanimann
dont le Mamco avait montré à plusieurs reprises l’autre
versant, le monde des images.
La démarche d’Alex Hanimann se place dans un ensemble
de pratiques contemporaines très diverses, au carrefour
de l’interaction entre l’art et les mots qui s’est nouée tous
azimuts dès le début du 20e siècle. La présence du langage écrit est en effet devenue de plus en plus insistante dans le
territoire plastique et la valeur proprement visuelle de l’écriture
est allée jusqu’à exclure de l’image tout autre élément
que le scripturaire. C’est exactement dans cette fracture
que s’articulent les deux pans des recherches d’Alex
Hanimann qui peuvent subrepticement se rencontrer sur
certains de ses dessins dans lesquels le texte survole tel
un titre le sujet dessiné ou vient s’inscrire dans une bulle
expressive de bande dessinée.
Lorsqu’il s’éloigne de l’image et travaille « purement » le langage,
Alex Hanimann en exploite tous les ressorts, du signe
typographique, du mot, de la phrase et de la phonétique au
passage d’une langue à une autre. À Ferdinand de Saussure
(1857-1913) pour qui « le signe graphique est une image ou
une forme à considérer en soi », Alex Hanimann répond par la
variété des usages qu’il insuffle au matériau typographique.
Les pages textuelles d’Alex Hanimann, qu’elles soient au
format du livre ou à celui du mur, n’évoquent pas la bigarrure
des textes de presse présents dans les œuvres cubistesmais s’établissent avec affirmation sur le terrain de l’écrit.
Lettres et chiffres acquièrent des propriétés visuelles autant
par leur forme dessinée ou dactylographiée que par leur
disposition sur la page. Le fait est connu, c’est à Stéphane
Mallarmé (1842-1898) que revient d’avoir brisé le carcan
imposé des typographes, mais il est curieux de constater
que l’invention du texte est ultérieure à celle de l’écriture.
L’histoire rapporte que c’est Zénodote d’Éphèse (IIIe siècle
avant J.-C.), premier directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie
qui devant les multiples difficultés de lecture et d’archivage,
notamment de la scriptio continua, aurait instauré le premier système d’organisation visuelle de l’écrit dans
l’espace de l’écrit : le blanc entre les mots1.
Le travail d’Alex Hanimann veut aller au-delà des pures
recherches graphiques dont elles ne constituent pas un
point d’arrivée mais, pourrait-on dire, un point de départ, un
déclencheur de l’imaginaire du spectateur, un embrayeur
linguistique. Il jongle avec les mots, attentif à leur sens età ceux qui peuvent survenir lorsqu’ils sont juxtaposés, assemblés,
soulignés, barrés, lus dans un sens inversé, traduits
dans une autre langue.
« Classer, c’est interpréter », aime à expliquer Alex
Hanimann. Observant et analysant sa production, multiple
— ses dessins-image et ses travaux sur le langage — mais également son imposante archive de photographies découpées
dans les journaux et magazines ponctuant la vie sociale
et politique, il lui a paru impératif, au risque de s’y égarer
soi-même, d’inventer son propre thesaurus. Des corpus se
sont alors constitués selon des thèmes. Son intérêt pour
la langue étant de l’ordre encyclopédique, son classement
thématique s’égraine en modes d’emploi, règles diverses,
jeux de langage, logique, langue banale, listes de mots,
axiomes, rythmique et sonorité des mots. Au même titre,
les images sont classifiées en groupes constitués par les
plantes, les animaux, les dessins abstraits, la danse, les personnages
qui agissent, les personnages qui se présentent… Peints sur le mur, soufflés dans des tubes de néons, dessinés à la gouache lettre après lettre puis assemblés dans des collages
monumentaux ou façonnés à la manière des enseignes
lumineuses, les textes d’Alex Hanimann, s’ils suggèrent de
possibles cohérences significatives, conservent toujours
quelque chose de « flottant ». À savoir qu’ils n’obligentà aucune signification précise et absolue. Celle-ci est à disposition
de qui veut la saisir, à la disponibilité du spectateur
de les lire et de créer ses propres associations.
1. Nina Catach, « Retour aux sources »,
Traverses, nº 43, février 1988, pp. 33-47.
|